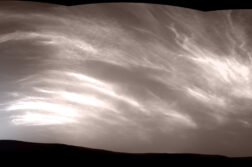La biodiversité est menacée sur Terre et un processus d’extinction massive du vivant est probablement en cours : une espèce de mammifères sur quatre, un oiseau sur huit, plus d’un amphibien sur trois et un tiers des espèces de conifères sont menacés d’extinction mondiale[1]. Après la disparition de quelques 800 espèces dans les 50 dernières années, selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, ce sont plus de 25.000 espèces qui pourraient bientôt disparaître.
Plus préoccupant encore le rythme de ces disparitions s’accélère. Il serait de plusieurs centaines de fois plus élevé que le taux naturel d’extinction, évalué d’après les données paléontologiques. Bien que l’estimation de cette vitesse de disparition des espèces soit encore un thème de débat, il semble qu’un consensus se fasse autour d‘une vingtaine d’espèces perdues chaque année. Si une telle estimation vertigineuse se confirmait, l’extinction en cours pourrait être du même ordre de grandeur que la 3ème extinction massive, celle du permien il y a 250 millions d’années, durant laquelle ont disparu près de 90 % des espèces alors vivantes. Le processus en cours serait donc bien plus sévère encore que le dernier épisode d’extinction, celui du crétacé, qui occasionna la disparition des dinosaures et de 50% des espèces vivantes, il y a 65 millions d‘années.
Sans nier l’existence du problème, il convient malgré tout de le replacer dans la perspective du temps long pour s’apercevoir que ce qui est annoncé comme la pire catastrophe devrait pouvoir être géré rationnellement par Homo sapiens.
Il y a 1,8 million d’espèces connues, une toute petite partie de l’ensemble des espèces dont le nombre est estimé entre 50 et 100 millions (bactéries inclus). Si on suppose que le taux actuel de disparition des espèces, déjà très élevé, montait encore en flèche pour atteindre 100 disparitions par an, il faudrait 16.000 ans pour arriver à un taux d’extinction de 90% des seules espèces connues (et 900.000 ans si on retient l’estimation haute du nombre total d’espèces). Une durée courte à l’échelle géologique mais qui laisse à l’homme le temps de se retourner.
L’espèce humaine qui retrouvera dans le futur un niveau de population conforme à l’équilibre durable de la planète, tirera profit de la politique de préservation qu’elle mène à l’heure actuelle et elle deviendra elle-même chef d’orchestre d’une biodiversité nouvelle dont elle sera à l’origine
Pour renforcer la biodiversité, la première voie possible, la plus « naturelle » et déjà pratiquée de nos jours, consiste à redonner vie à des espèces disparues à l’état sauvage mais dont on dispose encore de quelques spécimens conservés dans les zoos et les jardins botaniques.
Quelques précautions s’imposent malgré tout car réimplanter une colonie d’individus issus de spécimens captifs n’est cependant pas aussi simple qu’il n’y paraît : le milieu dans lequel vivait l’espèce sauvage peut aussi avoir été profondément modifié ou les individus peuvent se révéler incapables de retrouver les aptitude pour vivre en liberté. De nombreuses tentatives de réintroduction d’espèces disparues à l’état sauvage se sont ainsi soldées par des échecs. D’autres réintroductions ont eu des effets pervers en introduisant de nouvelles maladies dans la faune d’accueil ou en faisant fuir les autres animaux. L’espèce menacée réintroduite dans le milieu sauvage est alors devenue espèce envahissante voire nuisible. Avant toute relance d’une espèce disparue à l’état sauvage, la prudence et l’analyse approfondie du projet s’imposent.
Des réintroductions ont néanmoins connu des succès éclatants. En 1981, il ne restait que 254 gorilles des montagnes en Afrique Centrale et ils sont aujourd’hui environ 900 avec une population qui augmente de 3% chaque année. En 1987 les seuls condors de Californie étaient les 27 survivants abrités au zoo de San Diego, aujourd’hui ils sont plus de 400 dont une grande partie dans la nature à l’état sauvage. En 1989, le bouquetin a été réintroduit dans le massif du Vercors dans les Alpes françaises, ils sont aujourd’hui plus de 500 à l’état sauvage. On pourrait citer ainsi des dizaines d’exemples d’espèces sauvées in extremis.
Une autre possibilité, plus délicate et largement débattue lors d’une conférence de la TED soutenue par le magazine National Geographic, consiste à ressusciter des espèces disparues.[2] Les fossiles de dinosaures sont sans doute trop vieux pour permettre la récupération de leur ADN dans un état de conservation suffisant pour les rendre à la vie, comme dans le film Jurassic Park, mais nous ne sommes qu’au tout début de l’histoire et les biotechnologies progressent à pas de géants.
En 2012, Svetlana Yashina, David Gilinchisky de l’Académie des sciences de Russie ont retrouvés dans le pergélisol sibérien des fragments de fruit d’une plante archaïque de Silene Stenophylla. Les scientifiques ont prélevé sur ces restes glacés depuis 12.000 ans du tissu placentaire qu’ils ont ensuite placés dans un milieu de culture contenant des hormones végétales. Des pousses sont apparues qu’ils ont pu féconder en laboratoire avec du pollen, lui aussi trouvé dans le pergélisol. Le Silene Stenophylla était ressuscité !
L’institut de recherche sur la conservation des ressources naturelles qui dépend du zoo de San Diego en Californie a créé une banque où sont conservés à la température de l’azote liquide les tissus cryogénisés de plus de 1.000 espèces disparues ou en voie de disparition. Robert Lanza, un pionnier de la bio-ingénierie[3] a pu ainsi y puiser quelques cellules de Banteng de Java qu’il a réussi à transformer en cellules germinales. En utilisant une vache comme mère porteuse il est ensuite parvenu à faire naître un bébé banteng javanais qui se porte bien et est encore en vie.
Le retour du mammouth laineux en Sibérie, un challenge que se sont fixés plusieurs équipes russes de la « dé-extinction », n’est sans doute pas pour tout de suite, mais les biotechnologies progressent actuellement tellement vite que plus rien n’est impossible.
Dans le passé, chaque extinction massive a entrainé des ruptures importantes dans l’évolution du vivant, la sixième, celle que gèrera l’homme ne devrait pas faire exception. Après le sauvetage d’espèces quasi disparues, après à la résurrection d’espèces éteintes, la biodiversité pourrait bien être programmée et développée par l’espèce humaine pour son plus grand profit par l’émergence d’une nouvelle discipline : la biologie synthétique.
La biologie synthétique est l’application à la biologie des principes de l’ingénierie. Elle s’intéresse à la « reconstruction » d’un système vivant pour lui permettre d’acquérir une nouvelle fonctionnalité, par exemple produire une substance qu’il ne produit pas naturellement. Elle vise aussi à concevoir et à développer en laboratoire des systèmes biologiques qui n’existent pas dans la nature, donc à créer la vie elle-même, à partir d’éléments non-vivants.[4]
Selon Pierre Tambourin, directeur général du Genopole d’Evry « là où le généticien isole, caractérise, transfère un gène d’un organisme à l’autre, d’une cellule à l’autre, le biologiste de synthèse va concevoir un gène nouveau, à partir de morceaux d’autres gènes ou le synthétiser de toutes pièces. Il s’agit, en quelque sorte, de considérer le vivant comme un immense meccano, à partir duquel sont imaginés et construits de nouvelles entités, des micromachines (autoreproductibles ou pas), des systèmes qui n’existent pas dans la nature »[5].
Le concept remonte en fait au début du vingtième siècle avec la publication, en 1912, d’un ouvrage intitulé « La biologie synthétique ». Son auteur, Stéphane Leduc, un médecin français visionnaire y affirmait que la « biologie est une science comme les autres » et qu’elle « doit être successivement descriptive, analytique et synthétique ». Les propositions de Stéphane Leduc n’éveillèrent guère d’intérêt de son vivant et il fallu attendre presqu’un siècle pour qu’un centre de recherche dédiée à la cette discipline voit le jour grâce à l’Université de Californie qui créée, en 2003, le département « biologie synthétique » au sein du Laboratoire national Lawrence-Berkeley. Depuis la biologie synthétique a trouvé d’autres relais, notamment en Europe, et elle progresse à un rythme quatre fois supérieur à celui de la loi que Moore avait énoncé pour les micro-processeurs.
Une étape importante vers la vie artificielle a déjà été franchie par le chercheur américain Craig Venter qui a pu implanter un génome entièrement synthétique dans une cellule réceptrice. Pas encore la vie artificielle mais presque. L’ADN du génome a bien été construit entièrement avec des éléments synthétiques mais l’enveloppe cellulaire provenait encore d’une bactérie qui avait été vidée de son contenu. Cette réussite démontre néanmoins que la création de la vie artificielle est pour bientôt.
Loin des fantasmes de la science-fiction et de Frankenstein, la biologie de synthèse, travaille sur des projets de création d’organismes vivants utiles à l’humanité : micro-organismes capables de produire de l’hydrogène ou d’autres carburants, de détecter la pollution et de l’éliminer, de fabriquer des protéines, des vaccins, des médicaments, etc. Des avancées sont déjà réalisées, à partir de levures dont on a reconfiguré le métabolisme, pour produire par exemple l’hydocortisone ou le taxol, utile dans le traitement des cellules cancéreuses.
Les chercheurs essayent de réduire progressivement le nombre de gène d’une bactérie pour isoler le matériel génétique strictement nécessaire à la vie, vraisemblablement autour de 3 à 400, pour ensuite ajouter à ce génome minimal les composants requis pour obtenir l’usine cellulaire qui fabriquera le produit voulu ou conduira à la fonction souhaitée.
Les biochimistes essayent par ailleurs de créer des structures ADN nouvelles en imaginant toutes sortes de combinaisons des 4 bases nucléotides (A, T, C et G) qui composent le polymère de l’acide désoxyribonucléique. Plus audacieux encore, ils cherchent un polymère substitut de l’ADN capable de coder l’information et de conduire à une forme de vie qui reste à imaginer.
_____________________________________________________
[1] Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) – liste rouge mondiale des espèces menacées (version 2017.3).
[2] « Revive and Restore », conférence organisée en mars 2013 à Washington (D. C) par l’association TED et le National Geographic
[3] Robert Lanza, est actuellement le responsable scientifique de l’Institut Astellas pour la médecine régénérative et professeur associé à l’Université de Wake Forrest (Caroline du nord). Ses travaux sur les cellules souches, l’ingénierie cellulaire et le clonage sont internationalement reconnus.
[4] Synthetic Biology : An Introduction (2011) – Rapport de l’EASAC (European Academies Science Advisory Council). L’EASAC est formé par les académies nationales des sciences des États Membres de l’Union Européenne.
[5] Pierre Tambourin, « Biotechnologies », Encyclopedia Universalis.